Les coûts de la transition énergétique s’annoncent astronomiques. Qui va les payer ? Dans un monde harmonieux, les plus riches et les plus pollueurs seraient tout particulièrement mis à contribution. Mais l’hyper-riche américain, pollueur de tous les excès, acceptera-t-il de payer pour le réfugié climatique bangladeshi ou des îles Marshall ? Rien n’est moins sûr…
Le cheminement vers 2050 et les diverses transitions qui se profilent sera long, semé d’embûches et coûteux. Il nécessitera probablement du sang et des larmes mais surtout, très certainement, des sous. Ce dernier point nécessite que l’on s’y attarde. Comment financer – de manière efficace et équitable si possible – les coûts multiples liés aux diverses transitions, dont la transition énergétique, rendues nécessaires par le changement climatique et les multiples évolutions qui se profilent ? La question mérite d’être posée d’autant que dans ce registre, le « biais de normalité » prévaut très fortement. En dépit de son urgence, elle semble être tombée dans ce que Robert Proctor, historien des sciences de l’université de Stanford, appelle un « puits de désintérêt », dans lequel « le savoir s’évapore ; l’ignorance reprend le dessus ». On peut parier qu’une telle question, pourtant si cruciale, sera totalement enfouie sous une avalanche d’autres sujets, plus immédiats, plus polémiques et plus « bankables » médiatiquement lors des débats de la prochaine présidentielle française.
Le casse-tête du financement de la transition énergétique
Une telle question, pourtant si structurante, constitue un « angle mort » de la problématique « changement climatique », en particulier en France au regard de l’état des finances publiques, du poids de la dette actuelle, et du ratio « niveau du prélèvement fiscal / efficacité de la gouvernance ». Le creusement des déficits budgétaires et l’alourdissement de la dette coïncident, dans beaucoup de domaines, avec le recul lent mais régulier de la France dans bon nombre de classements internationaux. L’illustration la plus tragique (pour l’avenir) de ce phénomène est, sans nul doute, la dégringolade de notre pays depuis 2000 dans le classement PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) de l’OCDE, qui mesure le niveau d’éducation des élèves de 79 pays. Nul décideur politique ne peut se satisfaire d’une telle évolution.
Je n’insisterai pas sur ce point, clairement hors du périmètre de ce blog, mais il me semble nécessaire d’évoquer ce constat liminaire au regard des dépenses, considérables, qui se profilent au cours des trois prochaines décennies pour mener à bien les divers volets des « transitions » qui vont s’imposer dans de multiples domaines. Cet écart « coût / efficacité », que l’on pouvait assimiler jusqu’à présent à une « singularité française » n’est plus tenable. Face à l’ampleur des enjeux, chaque euro dépensé devra s’avérer pertinent à l’adaptation du pays et de ses habitants aux « temps nouveaux ».
Pour le seul sujet de la décarbonation de l’économie, un des enjeux centraux des prochaines décennies, la plupart des économistes évaluent à 4 % ou 5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, le besoin d’investissement brut supplémentaire découlant de la transition énergétique, c’est-à-dire les investissements nécessaires à la production et au stockage d’énergie renouvelable, à la construction de réseaux électriques intelligents, à la décarbonation de l’industrie et des transports et à la rénovation thermique des bâtiments et des logements. Un effort à reproduire annuellement pendant au moins 30 ans. Si on retire de ce bilan les investissements dans les énergies fossiles appelés à diminuer très fortement, le besoin d’investissement net supplémentaire serait encore de l’ordre de 3 à 4 points de PIB. Pour sa part, la cour des Comptes européenne estime que ce processus devrait mobiliser à l’échelle de l’UE 1120 Mds d’€ par an entre 2021 et 2030, dont 145 pour la seule France. Une somme bien « rondelette » à ajouter aux autres dépenses « traditionnelles » (sociales, de santé, de souveraineté…), les « nouvelles » dépenses liées aux transitions s’additionnant plutôt que se substituant aux anciennes. Il va falloir financer beaucoup et être très efficace dans la dépense, le temps étant compté pour s’adapter et le droit à l’erreur, minime.
Le citoyen ne peut être pris que de vertige devant les montants à assurer : dépenses budgétaires permettant de « faire tourner » l’Etat et préserver « l’harmonie » de la société (acheter la paix sociale en particulier) ; investissements dans les infrastructures et la R&D ; remboursement de la dette, et désormais, financement des « transitions », en France, en Europe et sur le reste de la planète. Car l’effort d’adaptation aux effets du changement climatique doit être global, universel et inclusif. Cet objectif induit que les pays développés (comme la France), principaux émetteurs historiques de GES, vont devoir accepter de financer une grosse partie des efforts d’adaptation des pays dits du « Sud », qui sont déjà – et vont être chaque année davantage – fortement affectés par des perturbations majeures (réchauffement, désertification, hausse du niveau des mer, acidification des océans…). Des maux planétaires pour lesquels leur responsabilité est minime, voire quasi-nulle. Le processus des COP prévoit à ce titre, la mise en place d’une contribution de 100 milliards par an à compter de 2023 jusqu’en 2030, dont une quote-part significative reviendra à notre pays.
Une somme à laquelle pourrait se rajouter – à terme – le paiement de compensations financières en faveur des pays du Sud même si pour l’heure, les Occidentaux rechignent à passer à la caisse sur ce point. Mais il leur sera vraisemblablement très difficile de tenir dans la durée une posture aussi négative, du fait de l’ampleur de leur responsabilité historique dans l’émission de GES depuis le début de la révolution industrielle en Europe. S’ils ont pu résister à ces demandes des ONG et des pays du sud lors de la COP 26 de Glasgow, les pays développés n’en ont pas fini avec ce dossier. Deux micro-Etats insulaires, Tuvalu et Antigua-et-Barbuda, ont pris l’initiative de constituer une commission des petits Etats insulaires auprès des Nations unies, avec comme objectif d’explorer les pistes juridiques permettant de demander des dommages et intérêts aux pays pollueurs devant des juridictions internationales, comme la Cour internationale de justice ou le Tribunal international du droit de la mer. Cette question devrait revenir sur la table lors des prochaines COP et le refus occidental s’étioler progressivement dans les années à venir, au risque de donner naissance, en cas de refus obstiné, à une ligne de fracture Nord / Sud des plus conflictuelles, certains protagonistes y jouant leur survie et n’ayant aucune marge de négociation.
Le besoin de « créativité fiscale »
Le nouvel environnement financier et fiscal qui se profile à l’horizon 2030 (je ne parle même pas de 2050), va confronter la France à des montants astronomiques de dépenses. A ce titre, l’option d’un apurement de la dette actuelle « pré-transition » (annulation ou autre « solution technique » aboutissant globalement au même résultat) devrait finir par s’imposer – au grand dam des tenants de l’orthodoxie budgétaire – afin de concentrer tous les moyens financiers et budgétaires sur la réalisation – vitale – des transitions – cruciales- à conduire en urgence pour adapter le pays et sa population et tenir ses engagements internationaux face à la nouvelle donne (climatique, technologique, sécuritaire, économique) en passe d’émerger.
Dans un tel contexte, la nécessité d’un « big bang fiscal », serpent de mer du débat politique français depuis des décennies, ne devrait pas manquer de revenir sur le devant de la scène, avec cette fois un impératif de passage à l’acte. Mais sur quel périmètre, de quelle ampleur, avec quels objectifs, au profit de quels gagnants et au détriment de quels perdants ?
Autant de questions complexes à trancher, d’autant que les réponses ne seront plus à apporter dans un contexte purement hexagonal mais – monnaie unique et espace économique et financier commun obligent – à l’échelle européenne. Avec comme fil rouge une impérieuse harmonisation fiscale, au minimum dans la zone euro. Au regard des échéances et des enjeux qui se profilent, les passe-droits, échappatoires divers et « petits arrangements entre amis » au profit d’Etats membres « fiscalement accueillants » (je salue à ce stade mes éventuels lecteurs luxembourgeois ou irlandais), de multinationales championnes de l’optimisation fiscale (pensée émue aux directions juridiques et financières des entreprises du CAC 40) et de gros contribuables « malins » (salutations aux personnes citées dans une récente enquête, très illustrative, publiée par Libération ou encore la longue liste de personnalités citées dans les « Pandora Papers »)ne seront plus de mise, au risque d’étouffer le projet européen sous le poids d’égoïsmes fiscaux insupportables.
Confrontées à une course contre la montre implacable (2050 et sa « nouvelle donne », « c’est presque déjà demain »), les autorités françaises et européennes vont devoir mettre en place ce qu’il faut bien appeler une « économie de guerre » pour faire face aux défis à venir et stopper tous les processus de dérivation, de contournement, d’exonération financière et fiscale et que chacun, du plus modeste au plus puissant, y aille de son écho, proportionnellement à son niveau de richesse. On peut espérer dans un tel contexte que le fisc hexagonal, dans la continuité de ses grandes avancées historiques (comme la mise en place de l’impôt sur le revenu en 1914 et surtout de la TVA / Taxe à la Valeur Ajoutée, en 1953), fasse preuve de créativité et contribue à résoudre ce problème de financement de la transition par l’élaboration de solutions fiscales innovantes.
Les hyper-riches payeront ! (peut-être…)
A ce titre, le dernier rapport du World Inequality Lab (WIL), publiées le 7 décembre dernier, est très instructif sur de nombreux sujets. Il confirme, chiffres à l’appui, qu’au regard des rapports de force politiques, sociaux et économiques prévalant sur tous les continents, le mode développé contemporain s’avère une redoutable ploutocratie. Celle-ci se caractérise par la prédominance d’un « archipel d’oligarchies » à travers le monde, « hyper-concentrant » entre ses mains l’essentiel du patrimoine et des revenus. Et cette tendance n’a fait que se confirmer ces dernières années, en particulier à l’occasion de la crise de la COVID-19. Les principaux responsables de l’étude (Thomas Piketty, Lucas Chancel, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman et Facundo Alvaredo) se sont abondamment exprimés dans les médias et il est aisé de retrouver la « substantifique moelle » de leurs travaux dans une multitude d’articles de presse.

Le rapport du WIL insiste tout particulièrement sur le lien entre lutte contre les inégalités sociales et mobilisation contre le changement climatique. Les données recueillies permettent d’établir une double corrélation pour penser la manière de gérer (et de financer) au mieux les transitions à venir :
- Au niveau international, les pays développés les plus riches sont historiquement responsables de l’essentiel des émissions de CO² ;
- Au niveau national, dans la très grande majorité des pays étudiés, les ménages les plus aisées s’avèrent les plus gros pollueurs nationaux, via des émissions « directes » résultant de leur train de vie et de l’achat de biens et services à forte empreinte carbone (mobilité très intensive ; recours facilité au transport aérien, voire pour certains ultra-riches, possession ou utilisation fréquente de jets privés ; achat de grosses cylindrées ; consommation de produits de luxe …) mais aussi via des émissions « indirectes » découlant d’investissements dans des secteurs d’activités grands émetteurs de GES (ex : possession d’actions de sociétés pétrolières ou de compagnies aériennes).
Les données du rapport du WIL indiquent que les 1% les plus fortunés de la planète ont émis en moyenne chacun 110 tonnes de CO² en 2019, soit 17% des émissions de dioxyde de carbone de cette année-là alors que la moitié la plus pauvre de la population mondiale n’en a émis en moyenne que 1,6 tonnes par personne, soit 12% des émissions totales de CO². Les variations sont importantes selon les continents. Les 10% les plus riches des Américains émettent en moyenne 73 tonnes de CO² par an contre 9,7 tonnes pour les 50% d’Américains les plus pauvres. Mais en raison des différences de niveau de développement, un Américain pauvre émet en moyenne plus de CO2 qu’un Africain « riche » (7,3 tonnes de CO²), tandis que la moitié la plus pauvre des Africains, (sur)vivant dans une « sobriété forcée », n’émet que seulement 0,5 tonne.
Les données compilées par les économistes du WIL montrent que sur l’ensemble des continents, les 50% les plus pauvres (qui vont d’une manière ou d’une autre pâtir le plus des changements climatiques à venir) génèrent des niveaux d’émission très raisonnables. A l’inverse, les classes moyennes supérieures et les ménages les plus aisées sont « sur-émetteurs » de GES du fait de leur mode de vie (travail, consommation, loisirs). Il est à parier que de tels écarts ne vont plus être supportables au cours des prochaines décennies. Ils alimentent d’ores et déjà les demandes de compensation des pays du Sud mais les fortes réticences des pays développés à accepter ce principe de compensation vont très probablement contribuer à alimenter des tensions internationales, laissant augurer un durcissement préoccupant des relations Nord/Sud.
Si les pays développés ont accepté, plus ou moins de bonne grâce, de « payer » une partie de la facture pour les pays du Sud (à hauteur d’au moins 100 milliards par an à compter de 2023, voire sans doute plus à terme), il va leur falloir disposer de ressources financières adéquates. La recherche de nouvelles formes de prélèvements fiscaux va constituer une action prioritaire des gouvernants pour financer la transition énergétique en interne et le respect des engagements solidaires au plan international.
Certains secteurs d’activité très polluants mais aujourd’hui très massivement exonérés pourraient ainsi « passer à la caisse ». On comprend mal, fin 2021, la détaxe dont bénéfice le kérosène utilisé dans le transport aérien, en vertu d’un accord international remontant à la fin de la seconde guerre mondiale (convention de Chicago de 1944). Une nécessaire adaptation du secteur aux temps nouveaux s’impose, aboutissant à une renégociation de cette clause qui apparaît chaque jour davantage « scélérate » du fait de ses effets dévastateurs sur l’environnement. Cette taxation pourrait être compensée par les compagnies aériennes par la mise en place d’une écotaxe sur les billets d’avions, dans l’attente de la mise en service du moteur électrique qui permettra de « verdir » réellement ce secteur d’activité. Pour sa part, le transport maritime semble prêt à s’engager dans la voie de cette adaptation. L’International Chamber of Shipping, qui représente 80% de la flotte marchande mondiale, propose l’instauration d’une taxe obligatoire par tonne de CO² émise par tout navire jaugeant plus de 5000 tonnes afin d’inciter la décarbonation au plus vite de la flotte mondiale, l’idée étant de rendre le fioul de moins en moins compétitif au profit de nouveaux carburants moins carbonés (à défaut d’être plus « verts ») comme l’ammoniac, le méthanol ou le biofioul. Plus globalement, une « sage gouvernance » devrait aboutir dans les prochaines années à l’élimination des subventions aux énergies fossiles (très coûteuses pour de nombreuses finances publiques) et l’instauration de taxes sur ces énergies afin de favoriser le recours privilégié aux celles étant renouvelables.
Mais le principe « pollueur / payeur » devrait également s’appliquer au niveau individuel. Le « sens de l’Histoire » semble tendre vers l’instauration d’un impôt universel proportionnel à l’empreinte carbone laissée. Les ménages aisés émetteurs de GES pourraient être appelés à contribuer davantage au financement des transitions qui se profilent, en particulier le processus de décarbonation de l’économie. La fiscalité, pour peu qu’elle soit équitable et suffisamment bien ciblée par rapport aux enjeux sociaux, financiers et climatiques, fait ainsi figure de levier majeur de la lutte contre le changement climatique. Pour un pays comme la France, le « big bang fiscal » qui finira bien par s’imposer à l’avenir, en dépit des combats d’arrière-garde livrés par une multitude de lobbies, devra prendre en compte les émissions individuelles de GES pour répartir au mieux les efforts devant être consentis, sur le même principe que la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Au-delà de l’instauration, potentiellement courant 2023, d’une taxe carbone aux frontières de l’UE (projet Carbon Border Adjustment Mechanism / CBAM) dans le cadre du Green Deal élaboré par la Commission, les décideurs français et européens pourraient devoir être obligés d’envisager au cours de la prochaine décennie la mise en place d’un impôt carbone progressif, au moins sur le patrimoine contribuant directement ou indirectement à l’émission de gaz à effet de serre.
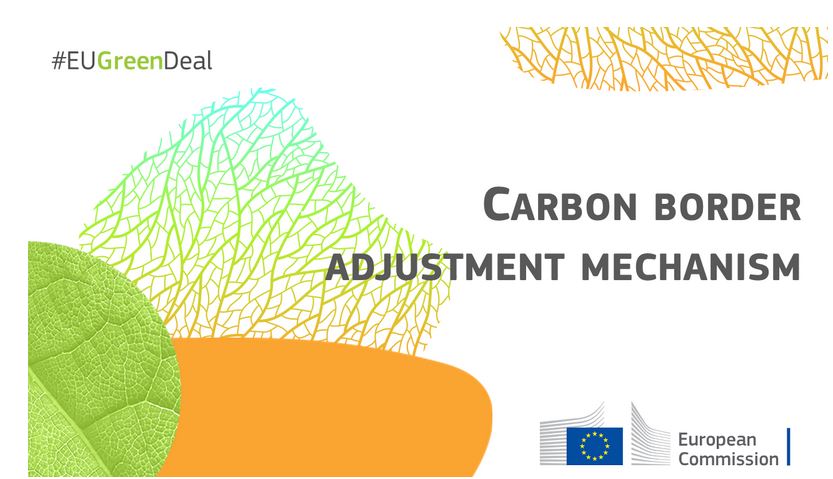
Les économistes du WIL plaident pour l’instauration d’un impôt progressif sur les plus hauts patrimoines combiné à un impôt pollution pour les détenteurs de titres de firmes opérant dans les secteurs carbonés ou ayant des activités polluante et émettrices de GES. Ces nouvelles formes de fiscalité ciblant les multimillionnaires pourraient rapporter selon certaines estimations 1,5 à 2% du PIB mondial, et permettre ainsi de financer une bonne partie des besoins d’investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’économie fixés par les accords de Paris de 2015.
Cette « créativité fiscale » permettrait, par ailleurs, d’éviter une fiscalité écologique aveugle, frappant autant les plus aisés que les plus pauvres, dont l’archétype cauchemardesque s’avère la taxe sur les carburants adoptée en 2018 en France et qui devait générer le mouvement des « gilets jaunes », la première grande jacquerie fiscale de l’ère de la transition énergétique.
Au-delà de la seule ingénierie fiscale, une gouvernance efficace pour lutter contre les effets du changement climatique devrait conduire à la mise en place de droits individuels sur le carbone. Chaque individu se verrait octroyer chaque année un quota de carbone (ou de GES), que chacun, au gré de ses activités, de son mode de vie ou des projets, serait libre de consommer, d’économiser, voire de revendre à plus « carbonivore » que lui.
Du passe sanitaire au « passeport carbone ».
Un tel « passeport carbone » serait à présenter pour tout achat de carburant, réservation d’un billet d’avion, voire dans une version encore plus ambitieuse et « globalisante », pour tout acte de consommation ou achat de titres boursiers. Chacun de ces actes équivaudrait à un niveau préétabli d’émissions de carbone ou de GES, conduisant à débiter le crédit carbone (ou GES) initial du consommateur. Un tel mécanisme permettrait aux plus humbles ne bougeant guère de leur quartier et consommant peu de tirer profit de leur sobriété (que celle-ci soit forcée ou volontaire) en revendant une partie de leur quota à l’influenceuse en vogue, désireuse d’aller effectuer son stage de 15 jours de yoga à Bali, ou au boursicoteur aspirant à accroître son portefeuille d’actions dans le secteur extractif, énergétique ou high tech (très gros émetteur de GES). Un tel mécanisme de limitation des déplacements peut apparaître au lecteur d’aujourd’hui une totale anticipation hautement liberticide, mais à l’ère du numérique et de la traçabilité du plus grand nombre, tout devient techniquement possible. Qui aurait pu imaginer voici encore 12 mois, l’acceptation par une très large frange de la population française, de l’obligation de présenter un passe sanitaire pour aller au restaurant ou prendre le train ? En la matière, la société française a fait preuve d’un grand sens de l’adaptation et de l’innovation face à un défi majeur. L’instauration d’un passeport carbone dans les prochaines années pourrait arriver bien plus vite que prévu, et pas seulement dans le cadre d’une hypothétique arrivée au pouvoir des Verts. Une gouvernance responsable de la transition énergétique pourrait bel et bien conduire tout parti aspirant à exercer des responsabilités de gouvernement à tendre vers un tel dispositif, urgence climatique et financière obligent.
Pas de doutes que les moyens techniques pour établir un suivi individuel de l’empreinte carbone de chacun existent déjà. Mais si la France – ou tout autre pays! – décidait d’agir, n’y aurait-il pas un grand risque d’évasion à cette nouvelle fiscalité avec le mouvement de personnes et changement de résidence/pays? Peut-on espérer une bonne coordination internationale? C’est difficile d’y croire dans des délais compatibles avec le calendrier du réchauffement climatique.